Dans son ouvrage Le management des réseaux – Tisser du lien social pour le bien-être économique (de Boeck), Christophe Assens, maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, présente le résultat de vingt années de recherches portant sur les réseaux en management stratégique. Il vient d’être récompensé par une Mention Spéciale. Entretien.
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
 Christophe Assens – Ce livre est le résultat de vingt années de recherche sur les réseaux en management stratégique. A travers une analyse macro, méso et micro, le but de cet ouvrage est de donner du sens à un mot-valise et de permettre aux décideurs de s’approprier le terme à bon escient. Mon but est de faire comprendre en quoi le management des réseaux peut apporter des avantages concurrentiels par rapport à d’autres modalités stratégiques.
Christophe Assens – Ce livre est le résultat de vingt années de recherche sur les réseaux en management stratégique. A travers une analyse macro, méso et micro, le but de cet ouvrage est de donner du sens à un mot-valise et de permettre aux décideurs de s’approprier le terme à bon escient. Mon but est de faire comprendre en quoi le management des réseaux peut apporter des avantages concurrentiels par rapport à d’autres modalités stratégiques.
Aujourd’hui, quand on pense réseau, on pense immédiatement technique. Mais ce n’est pas tout ! Dans un contexte de crise de légitimité des institutions, le réseau a le mérite de représenter un modèle alternatif : au-delà de la partie visible et de la frénésie qui entoure « les autoroutes de l’information », il permet de se poser la question du sens et des valeurs partagées dans des organisations où le lien social a une importance fondamentale – y compris pour créer de la valeur économique !
Votre ouvrage vise-t-il à réinventer le management ?
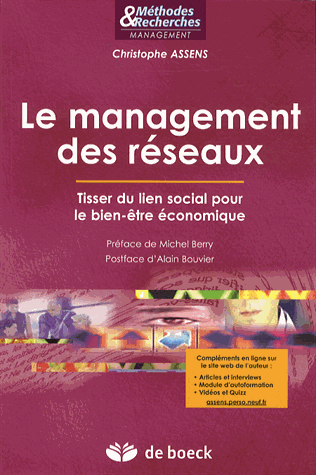 Mon travail n’est pas idéologique, il ne porte pas d’ambition révolutionnaire. Il n’est pas non plus motivé par la nostalgie ou le goût de la science-fiction ! Au contraire, mon travail s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie de marché et de la mondialisation – des réalités indéniables qu’il convient de bien appréhender.
Mon travail n’est pas idéologique, il ne porte pas d’ambition révolutionnaire. Il n’est pas non plus motivé par la nostalgie ou le goût de la science-fiction ! Au contraire, mon travail s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie de marché et de la mondialisation – des réalités indéniables qu’il convient de bien appréhender.
Les entreprises et organisations qui « performent » sont celles qui parviennent à casser les idéologies, avec pragmatisme, ce qui leur permet d’avancer dans un monde nouveau et complexe. On observe que, pour avancer, une organisation doit chercher une forme de consensus social et fonctionner de manière participative – sans trop en faire non plus sur ce dernier point : trop de participatif peut nuire au bon fonctionnement d’une structure…
Vous définissez le réseau comme un équilibre entre autonomie de chacun et dépendance mutuelle. Comment les entreprises managent-elles cela ? Quelles sont les difficultés qu’elles peuvent rencontrer ?
Une chose est certaine : il ne faut pas verser non plus dans le tout-collectif ! Car il y a un point où le collectif risque d’étouffer les initiatives individuelles dont l’entreprise a besoin. L’autre problème est celui de l’évaluation et de la décision : le tout collectif et l’égalité parfaite entre chacun entraîne le consensus mou. Les acteurs se retrouvent juges et parties et ne prennent les décisions que pour maintenir la paix sociale. Le réseau développe alors ses propres règles de survie, au détriment de l’organisation.
Il existe des « entreprises sans chaise », où le leadership est partagé, comme celle de Michel Hervé [le Groupe Hervé, NDLR]. Elle génère 450 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 2 500 salariés, la démocratie participative y porte sur les aspects fonctionnels et opérationnels… mais les salariés ne sont pas associés au capital. Cette démarche existait dès la naissance de l’entreprise, elle perdure depuis une quarantaine d’années.
Le réseau est-il appréhendé de la même manière partout ?
 Le travail sur les réseaux révèle les idéologies. Aux Etats-Unis par exemple, l’esprit d’entreprise s’oppose aux réseaux : ces derniers sont associés à une défaillance du marché. En Italie c’est totalement différent.
Le travail sur les réseaux révèle les idéologies. Aux Etats-Unis par exemple, l’esprit d’entreprise s’oppose aux réseaux : ces derniers sont associés à une défaillance du marché. En Italie c’est totalement différent.
Les Italiens se méfient de toutes les institutions et ont tendance à recréer des univers propres, autour du lien du sang – le noyau de la structure familiale est le centre de gravité de la société italienne. On va retrouver cette logique de réseaux familiaux dans l’entreprise ou dans un autre cadre, celui des mafias par exemple.
En France, le prisme idéologique fort est celui de l’Etat et des pouvoirs publics : on ne peut pas concevoir le réseau sans qu’il découle d’une décision politique, d’un processus bureaucratique et administratif.
Il est difficile de sortir de ces cadres idéologiques, souvent nationaux, qui enferment l’acception du réseau. Pourtant, cette notion et sa logique peuvent apporter des solutions nouvelles dans un monde complexe, en permettant de résoudre les tensions « social / économique », « local / global », « individuel / collectif ».
D’où votre proposition de « capitalisme de réseau » ?
Le but du livre est de comprendre comment le réseau peut incarner les nouveaux modes d’organisation, au sein des entreprises notamment. Fondamentalement, je pars du principe que le capitalisme de réseau peut compléter utilement le capitalisme de marché et le capitalisme d’Etat.
Le capitalisme de marché correspond à la défense des intérêts privés. Le capitalisme d’Etat, à la défense de la chose publique. Le capitalisme de réseau correspond, lui, à la défense des biens communs. Ce dernier peut se décliner de trois façons.
- Tout d’abord, le réseau administré : c’est celui des banques à vocation sociale, des sociétés coopératives et participatives (Scop), des mutuelles. La difficulté est de fédérer politiquement ce réseau.
- Viennent ensuite les réseaux distribués : ce sont ceux issus de l’économie du partage, de l’économie collaborative. Cela concerne toutes les formes d’autogestion.
- Enfin, il y a les réseaux pilotés : ils fonctionnent dans une économie conventionnelle, avec des entreprises qui pilotent l’activité par la confiance et organisent des transactions sous la forme de don – contre-don. Bouygues, par exemple, travaille par appels d’offre sur un marché où la concurrence est énorme. Lors des deux premiers appels d’offre, l’entreprise va choisir ses sous-traitants en se fondant sur des critères économiques comme la qualité des services, le coût et les délais. Puis au moment du troisième appel d’offre, Bouygues va nouer un partenariat avec le sous-traitant choisi précédemment. Ceci ne relève pas de l’intégration hiérarchique ni exactement de logiques de marché, mais d’une logique de réseau où la confiance tient une place importante.
Airbus est un autre bon exemple de réseau piloté. L’entreprise, au lieu de chercher des sous-traitants aléatoires, va les fidéliser : ils vont devenir des partenaires dans un réseau. Airbus va les accompagner dans leurs démarches qualité et va même opérer un transfert de technologie. C’est une des raisons pour lesquelles le consortium Airbus est plus efficace que Boeing : Airbus sait s’ajuster et se montrer flexible tout en restant compétitif.
* A lire également :
> Le “choc des capitalismes”… et maintenant ? Entretien avec Daniel Pinto, Grand Prix de la Fondation ManpowerGroup / HEC Paris
> “Si on revient au travail réel, on libère la valeur” : la subsidiarité pour réinventer le travail, entretien avec Pierre-Yves Gomez, Prix des Elèves HEC Paris / Fondation ManpowerGroup







