Telle est l’analyse de Daniel Pinto, cofondateur et PDG de Stanhope Capital et auteur du livre Le choc des capitalismes – Comment nous avons été dépossédés de notre génie entrepreneurial et comment le réinventer -, qui vient de recevoir le Grand Prix de la Fondation ManpowerGroup / HEC Paris. Entretien.
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Qu’entendez-vous par « choc des capitalismes » ?

Daniel Pinto – Depuis une vingtaine d’années, je suis de près l’évolution du secteur financier : ce livre est en quelque sorte un témoignage. Avec la crise de 2008, le monde occidental est entré dans un système de crises répétées, liées au fait qu’on avait poussé les créateurs de côté et qu’on les avait remplacé par des marchés financiers non contrôlés. Les banquiers ont été stigmatisés, ceci me gênait car le secteur financier n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’iceberg lui-même, ce sont les sociétés cotées. Toutes les grandes sociétés cotées sont focalisées sur le court terme, les patrons sont devenus myopes. Le court-termisme de l’actionnariat couplé à celui du management sont les ingrédients d’une crise répétée. Dans le capitalisme financier occidental, les créateurs d’entreprise ne sont plus respectés. Les grands groupes sont soumis aux résultats trimestriels dans lesquels l’actionnariat est devenu sans visage, les patrons n’ont pas intérêt à investir pour l’avenir.
En face, le capitalisme des pays émergents ressemble au capitalisme occidental d’il y a trente ans : les actionnaires sont les fondateurs, ils ont donc le courage de prendre les décisions pour les dix prochaines années. La finance joue encore un rôle accessoire en Chine ou en Inde : elle est là pour financer l’économie réelle. Ce lien entre l’actionnariat et le management représente une réelle capacité pour l’avenir.
Et le lien actionnariat-management représente un avantage certain pour les économies émergentes dans la compétition mondiale, il crée la possibilité d’avoir le courage d’agir pour l’avenir. Ce décalage constitue un choc, les conséquences seront graves pour nous si nous ne nous réveillons pas.
Des solutions concrètes pour en finir avec le diktat du court terme
Les PDG-administrateurs auraient remplacé les bâtisseurs, comment en sommes-nous arrivés là ?
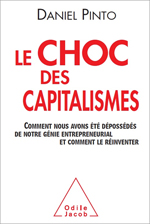 Dans les années 90, les fonds de pension et compagnies d’assurances, traditionnellement plus gros segments du monde institutionnel, se sont fait éclipsés par les fonds d’investissement. Les premiers investissent pour comptes propres avec une optique de long terme. Les seconds investissent pour compte de tiers avec une obsession de la performance à court terme. Cela a créé un déséquilibre et la pression s’est répercutée sur les managers par effet domino. Les boards se sont pliés à cette nouvelle donne et ont mis en place des packages d’incentives sur un à trois ans. Dans les grandes entreprises, ce fut le début du diktat du court terme.
Dans les années 90, les fonds de pension et compagnies d’assurances, traditionnellement plus gros segments du monde institutionnel, se sont fait éclipsés par les fonds d’investissement. Les premiers investissent pour comptes propres avec une optique de long terme. Les seconds investissent pour compte de tiers avec une obsession de la performance à court terme. Cela a créé un déséquilibre et la pression s’est répercutée sur les managers par effet domino. Les boards se sont pliés à cette nouvelle donne et ont mis en place des packages d’incentives sur un à trois ans. Dans les grandes entreprises, ce fut le début du diktat du court terme.
Tout récemment, IBM a décroché. Il a perdu en compétitivité face à des groupes plus agressifs et créatifs. Ce géant a dépensé 135 milliards de dollars en rachat d’actions et dividendes… mais n’en a consacré que 35 milliards aux capacités de production, qui déterminent le progrès réel de l’entreprise : le rapport est de un à quatre ! Or beaucoup d’analystes affirment que les rachats d’action sont une méthode pour augmenter les résultats, qu’ils permettent aux cours de bourse de monter mais ne constituent nullement un investissement dans l’avenir.
Comment passer d’un leadership d’administrateurs à un leadership d’entrepreneur ?
L’économie a beau s’accélérer, les cycles ne sont pas si courts. Dans l’industrie pharmaceutique, par exemple, produire un nouveau médicament prend 10 à 15 ans ; dans l’automobile, c’est de l’ordre de 5 à 7 ans, dans l’informatique entre 3 et 5 ans. L’exemple de Dell est justement révélateur : pour pouvoir se restructurer, son fondateur a racheté l’entreprise et a décidé de la décoter. Une décision radicale mais nécessaire : les marchés financiers ne pouvaient pas lui laisser le temps dont il avait besoin pour opérer cette restructuration. Même quand il faut se réinventer, il faut du long terme. Or une société cotée qui n’a plus d’actionnariat de référence et qui « incentive » [méthodes utilisées pour stimuler la motivation des cadres d’une entreprise, NDLR] de manière non adéquate n’a pas de pilote qui puisse prendre ce genre de décision.
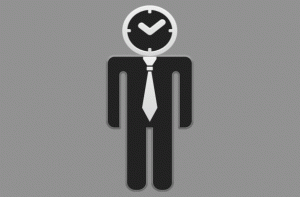 Il faut donc avoir le courage de fonder les « incentives » sur la croissance des chiffres d’affaires, sur des périodes de 5 à 10 ans, et non plus sur la performance des cours de bourse. Pour que le patron (re)devienne entrepreneur, je recommande également que le PDG investisse son propre argent – par exemple 10% de leurs actifs liquides. Avec ces mesures concrètes, on pourrait recréer le lien émotionnel entre le management et l’activité de l’entreprise.
Il faut donc avoir le courage de fonder les « incentives » sur la croissance des chiffres d’affaires, sur des périodes de 5 à 10 ans, et non plus sur la performance des cours de bourse. Pour que le patron (re)devienne entrepreneur, je recommande également que le PDG investisse son propre argent – par exemple 10% de leurs actifs liquides. Avec ces mesures concrètes, on pourrait recréer le lien émotionnel entre le management et l’activité de l’entreprise.
Mon livre a été traduit en anglais, il critique notamment le modèle financier à l’anglo-saxonne. Mais il est très bien accueilli parce qu’il propose des solutions concrètes qui ne passent pas par la réglementation : repenser les « incentives », proposer une base d’actionnariat élargie, transformer le PDG en entrepreneur et repenser la gouvernance des entreprises. Toutes ces propositions résonnent bien dans leur esprit.
Apprendre des émergents et de la Silicon Valley
Vous affirmez que les émergents nous ont « volé » le capitalisme, qu’ils ont imité ce qui a fait les fondements du capitalisme – et qui n’aurait plus cours aujourd’hui en Occident. Au-delà de cet aspect, ces émergents n’auraient-ils rien de singulier à nous apprendre ?!
Oui, le capitalisme des émergents a des caractéristiques propres. Les Chinois comme les Russes ont une économie dirigée, la collusion entre l’Etat et secteur privé est presque caricaturale en Chine. En Occident, on considère depuis 20 ou 30 ans que l’Etat ne doit plus se mêler d’économie, voire que toute intervention étatique menait à des catastrophes. Mais dans certains secteurs comme la défense ou l’aéronautique, où les investissements sont énormes, il faut une coopération entre le privé et le secteur public ! Les Etats-Unis ont pratiqué cet interventionnisme par le passé, il faut s’en souvenir : l’armée américaine est à l’origine de beaucoup de technologies [NDLR : le Pentagone aurait, par exemple, créé Internet], par ses investissements dans la recherche et ses projets pilotes.
Aujourd’hui, les Etats occidentaux sont non interventionnistes…mais deviennent des pompiers en cas de catastrophe. Une des leçons à tirer des pays émergents, c’est que l’Etat a un rôle à jouer, notamment en termes de planification. La planification n’est pas un mal, elle permet de donner une feuille de route.
Les grandes entreprises se revendiquent de plus en plus d’un « esprit start-up » : y a-t-il ici quelque chose de nouveau, qui invite à l’optimisme ? La Silicon Valley ouvre-t-elle une nouvelle voie pour le capitalisme, comme certains l’affirment ?
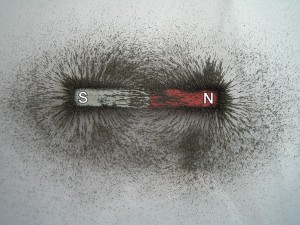 Les grands groupes restent hyper hiérarchiques, sans promotion réelle du courage entrepreneurial : il y a un grand décalage entre leur discours – l’affichage de l’esprit start-up – et les réalités quotidiennes. Autrefois, les unités de banques étaient comme de petites entreprises ; aujourd’hui tout a été centralisé, la gestion de risque comme les décisions commerciales. Résultat : les clients sont plus malheureux et les risques sont démultipliés. Je pense qu’il faut apprendre à faire confiance aux employés et collaborateurs : plus on leur fait confiance, plus ils vont s’investir dans leur travail et donner des résultats. Quand on centralise, on perd la qualité de la décision, la réactivité et on démultiplie les risques, qui sont plus importants au niveau central qu’au niveau local. Redonner aux employés le sentiment qu’ils sont entrepreneurs au sein d’un groupe, voilà une vraie réflexion managériale à engager. En France, on a beaucoup parlé d’actionnariat salarié… mais la réalité, c’est que rien n’a été fait pour encourager les salariés à devenir actionnaires.
Les grands groupes restent hyper hiérarchiques, sans promotion réelle du courage entrepreneurial : il y a un grand décalage entre leur discours – l’affichage de l’esprit start-up – et les réalités quotidiennes. Autrefois, les unités de banques étaient comme de petites entreprises ; aujourd’hui tout a été centralisé, la gestion de risque comme les décisions commerciales. Résultat : les clients sont plus malheureux et les risques sont démultipliés. Je pense qu’il faut apprendre à faire confiance aux employés et collaborateurs : plus on leur fait confiance, plus ils vont s’investir dans leur travail et donner des résultats. Quand on centralise, on perd la qualité de la décision, la réactivité et on démultiplie les risques, qui sont plus importants au niveau central qu’au niveau local. Redonner aux employés le sentiment qu’ils sont entrepreneurs au sein d’un groupe, voilà une vraie réflexion managériale à engager. En France, on a beaucoup parlé d’actionnariat salarié… mais la réalité, c’est que rien n’a été fait pour encourager les salariés à devenir actionnaires.
Ce qu’on peut apprendre de la Silicon Valley se résume en trois points. Tout d’abord, le mode d’organisation. Google a une structure très plate par exemple : les employés peuvent parler à Sergey Brin. Deuxièmement, le mode de financement et son lien avec le management : les fondateurs et managers sont actionnaires, et l’actionnariat est bien plus large que dans les entreprises traditionnelles, il inclut les salariés – ce qui constitue une bonne façon de donner le sentiment aux personnes qu’elles sont un peu propriétaires de l’entreprise, même à un petit niveau. Enfin, les entreprises de la Silicon Valley reposent sur un mode perpétuel de destruction / reconstruction. Ce sont donc des entreprises agiles… capables de restructurer l’intégralité de secteurs d’activité !
* A lire également :
> “Si on revient au travail réel, on libère la valeur” : la subsidiarité pour réinventer le travail, entretien avec Pierre-Yves Gomez, Prix des Elèves HEC Paris / Fondation ManpowerGroup
> “Le management en réseau, c’est la défense du bien commun !” : entretien avec Christophe Assens, Mention spéciale du jury Fondation MapowerGroup / HEC Paris







